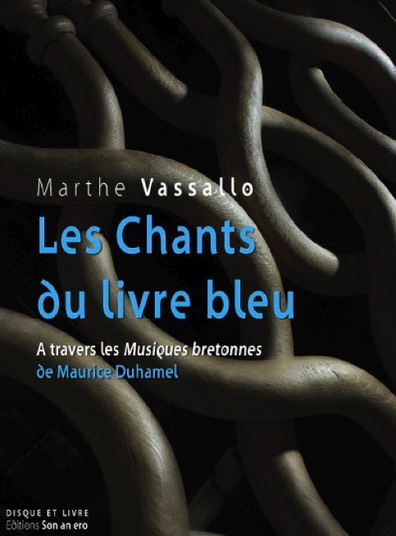J'ai commencé à écrire ce texte il y a plusieurs jours ; les perspectives bougent si vite, dans les situations de crise, que si j'en commençais un aujourd'hui il présenterait un autre angle. Cependant je pense que ce que celui-ci raconte est encore d'actualité – quoique voué, au mieux, au vieillissement accéléré des mots d'urgence, et au pire au flagrant délit de bêtise ou de brassage de vent, tous risques qui sont la loi des chroniques. Voici donc.
Il faut dépasser l'évènement, il faut en parler.
La menace est partout, la probabilité est faible.
C'est un acte sans précédent, c'est quelque chose qui se produit souvent ailleurs dans le monde.
Il faut pleurer les victimes, il faut lever nos verres, rire et chanter.
Rien ne sera plus comme avant, nos valeurs sont intactes.
Conserver nos libertés en augmentant la surveillance et la répression.
Les réfugiés fuient les terroristes, des terroristes se sont mêlés aux réfugiés.
Nous ne risquons rien, le pire peut arriver à tout instant.
C'est une horreur absolue, c'est moins qu'un crash d'avion.
Nous sommes en guerre, nous sommes en paix.
N'ayez pas peur, tout est à craindre.
Il est interdit de lire cette phrase.
Cette dernière ligne est l'exemple souvent donné pour expliquer ce que les psys appellent la "double contrainte" ou injonction paradoxale : un ordre impossible à suivre parce que ses termes se contredisent entre eux. L'injonction paradoxale est un bon moyen de faire craquer quelqu'un, du salarié ("va falloir innover, et surtout pas de surprises, hein") au rat de laboratoire ("ne bouge pas et va prendre ce bout de St Nectaire là-bas").
Depuis ce cauchemardesque vendredi, nous nous débattons tous dans les affirmations contraires. Et au bout d'une semaine déboussolée, je crois qu'il n'y a qu'une chose que nous pouvons tenter : puisque les contraires sont vrais, les uns et les autres, et qu'ils ne vont pas de si tôt cesser de l'être, la seule chose peut-être à notre portée est de ne pas les laisser devenir des injonctions. La peur sera là, en même temps que la certitude mathématique d'être bien plus en danger de périr dans un accident de voiture. La douleur est là en même temps que l'envie furieuse de chanter, de danser, de rire et même, pour des moments de plus en plus longs, d'oublier. Il est à la fois vrai que les crimes de ce vendredi 13 sont des "actes de guerre" et que nous ne sommes pas "un pays en guerre", comme le rappelait judicieusement un photographe de l'AFP habitué des théâtres de conflits. A la fois vrai que le bilan est atroce et inouï pour nous, et qu'il pèse peu en regard de ceux que connaissent régulièrement d'autres pays. A la fois vrai que la brusque réappropriation collective du drapeau tricolore et de la Marseillaise porte le germe potentiel d'un repli nationaliste, et qu'à l'inverse elle fait aussi échapper ces symboles aux nationalistes qui les accaparaient jusqu'alors. Je me souviens de notre perplexité à voir les USA, après le 11 septembre, se couvrir d'une éruption de petits drapeaux étoilés, aux rétros des voitures, aux portes des maisons…
Chacune de ces observations, qui contredit l'autre, ne l'annule cependant pas, et c'est ce que nous avons à appréhender. Or dans cet "état d'urgence" au sens propre, émotionnel, une des choses que nous cherchons à faire est de tirer des conclusions pratiques : face au mystère de l'agression, au danger nouveau sans référence (pour nous) et sans contours, nous voulons comprendre quoi faire. Et si nous laissons chacun des faits observés nous imposer, par déduction, un ordre, une marche à suivre, un "donc il faut" simple et exclusif ("d'autres attentats sont à craindre", donc il faut se méfier en tous lieux ; "le risque est statistiquement inférieur à celui d'un accident", donc il ne faut pas avoir peur ; le drapeau se retrouve souvent dans le langage de l'extrême-droite, donc il ne faut pas l'arborer ; le drapeau est le signe de la solidarité, donc il faut le porter à la boutonnière, etc.), nous nous retrouvons rats de laboratoire épuisés par les décharges électriques incompréhensibles. (Et toujours sans St Nectaire.) C'est même là un des objectifs de tous les terrorismes, et peut-être une des raisons pour lesquelles tout le monde se saisit, en ce moment, du terme de "guerre" : si l'on est officiellement en état de guerre, il devient (horriblement) logique de se faire tirer dessus. Peut-être est-ce une notion plus facile à manier que celle de pouvoir soudain, en buvant son café sans vouloir de mal à personne, se retrouver l'objet d'une volonté d'annihilation.
Nous nous retrouvons aussi empêtrés dans nos propres mots. J'en ai fait la risible expérience lundi 16, quand, après avoir accepté de donner, parmi d'autres, mon avis sur l'après-attentats pendant quelques minutes par téléphone sur France Bleu, je me suis retrouvée à patauger lamentablement. Tout m'échappait, les mots de mon breton, l'articulation entre ce que j'éprouvais le besoin de dire et ce que disaient mes interlocuteurs. Si j'avais accepté cette interview, c'était à contrecœur : je ressentais, depuis le vendredi soir, une fort inhabituelle envie de me taire. Une incapacité à dire quelque chose de sensé, en raison d'une incapacité non à penser, mais à agencer mes lambeaux de pensée en quelque chose qui ne soit pas une gigantesque contradiction. (Ceux qui me connaissent mesureront à quel point la répugnance à donner mon avis, doublée d'une incapacité à mettre deux phrases l'une derrière l'autre, est chez moi un symptôme frisant le surnaturel, du moins une fois exclue l'hypothèse d'un état d'ébriété de fréquence quinquennale ou d'une rupture d'anévrisme.) Parce que – je l'ai compris un peu plus tard – où que j'aille mentalement, je ne pouvais filer aucune pensée sans être accrochée par le fil opposé.
Je n'ai pas de solution miracle à ce problème. Je vais seulement un tout petit peu mieux depuis que je crois l'avoir identifié… Et que j'essaie de ne plus me plier à la demande impérieuse de chaque fil, dans la violence de la situation, d'être suivi, et suivi seul. Parmi les contraires exacerbés qui nous cernent, certains n'appellent pas de décision de notre part parce qu'ils concernent des domaines sur lesquels nous n'avons pas prise ; et ceux qui en réclament ("chanté-je ou ne chanté-je point La Marseillaise ?", "Vais-je au concert, au café ?", "Dois-je ou ne dois-je pas changer d'avis à propos des réfugiés ?"), nous ne pouvons leur faire face que si nous ne laissons pas chaque contraire nous hurler à la figure qu'il veut être seul entendu.
(PS : Et si ça vous intéresse, dans mon cas précis les réponses sont : la Marseillaise, à ce jour, non, parce que j'ai vraiment un problème avec ses paroles, mais je n'irai pas jeter la pierre à ceux à qui elle raconte autre chose ; le concert et le café, trois fois oui ; et l'attitude envers les réfugiés, eh bien si vous voulez en aider concrètement quelques-uns, je me permets un petit message subliminal : association l’Auberge des Migrants.
Leur site internet n'est pas très à jour, ils actualisent surtout sur Facebook. On peut leur faire un don via Paypal, je dis ça, je ne dis rien…)