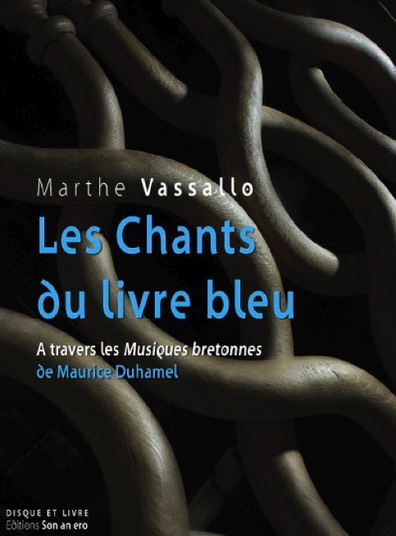« Hi! We met last week. »
« Yeah, I remember. »
Est-ce vrai qu’il se souvient de nous ? Ce jeune homme du comptoir des bagages perdus, à l’aéroport de Hambourg, a un flegme concentré qui lui ouvrirait une carrière de professionnel du poker ou de valet personnel du Prince Charles. Après consultation des oracles électroniques, il nous confirme que nos trois valises sont bien, depuis une semaine, « là ». Là, c’est à dire quelque part dans l'estran de valises en souffrance derrière nous : de cette immense salle d’arrivée des bagages, les trois quarts sont recouverts, comme une plage d’algues vertes un mauvais matin, de centaines, de milliers de valises. Des valises partout, des valises par terre, des valises sur une demi-douzaine des grands tapis roulants – rangées debout et bien serrées pour gagner de la place, des valises à perte de vue. En avant-plan, un massif d’encombrants, poussettes, instruments de musique et de sports… « Allez-y, si vous les trouvez. »
Gilles Le Bigot part vers la droite, Jean-Michel Veillon et moi vers la gauche. L’histoire connaîtra un happy end inespéré, parce que les heureux hasards de ma désorganisation coutumière font que j’étais partie non avec ma valise avion officielle, d’un anthracite on ne peut plus commun, mais avec une autre d’un modèle et d’une nuance de bleu beaucoup moins répandus dans les soutes, ce qui me permettra assez vite de repérer sa petite poignée au milieu de la marée à roulettes. (Note : pour le prochain voyage, apposer des autocollants fluos sur tous les côtés de la valise soute.)
Je retourne signaler la bonne nouvelle au comptoir ; le jeune homme s’est absenté, c’est une de ses collègues qui voit arriver ma mine réjouie et m’accueille d’un « vous les avez trouvées ? » incrédule. Est-ce l’empathie face à mon soulagement, ou la rareté du miracle, ses traits se chiffonnent un instant : je jurerais qu'elle est au bord des larmes.
Ce qui s’est passé à Hambourg, et qui nous a valu de devoir racheter en catastrophe des vêtements pour une semaine de tournée (ma mission : trouver en deux heures et demie trois tenues, dont une robe de scène, dans un centre commercial géant ! Ce que j’ai fait, aucune bête ne l’aurait fait !), c’est ce qui se passe dans beaucoup d’aéroports en ce moment. C’est aussi, je crois, ce qui s’est passé plus ou moins en chacun de nous ce printemps.
Pendant la pandémie, les compagnies et les aéroports ont rabattu de la toile : pas besoin de garder les mêmes ressources humaines quand l’activité est si dramatiquement différente. Au redémarrage de cette année, ils ont péché par manque d’anticipation et/ou se sont probablement dit « profitons-en, et voyons à quel niveau minimum d’emploi nous pouvons fonctionner ». Eh bien, la réponse est claire : pas à celui-là ! Correspondance prévue trop courte (ça, c’est Air France), retard au démarrage du premier avion (ça, c’est l’aéroport de Nantes, dont je tire mon chapeau au personnel qui se mettait vraiment en quatre pour que personne ne rate son vol malgré la file d'attente), thrombose du traitement des bagages (c’était Hambourg pour nous, mais j’ai ouï dire que c’était pareil un peu partout, à Amsterdam, à Londres… et guère plus brillant à Paris). Quelles qu’en soient les raisons, les acteurs semblent avoir sous-estimé la brusquerie du retour à la pleine activité ; et cela va leur coûter cher, en dédommagements (1), en image et, je le soupçonne fort, en craquages de salariés lessivés si cela devait perdurer.
Une soudaine avalanche de travail après deux années certes pas inactives mais dans un monde parallèle ; des moyens insuffisants ; en conséquence, des cascades d’erreurs grandes et petites et un déploiement d’efforts supplémentaires pour les réparer… Vous, je ne sais pas, mais moi ça me rappelle quelque chose.
Ça me rappelle moi. Ça me rappelle à peu près tout le monde autour de moi.
Les fidèles lecteurs du Kerbiquet Wheneverly savent que la fatigue et moi, on se connaît bien. Cela fait bien longtemps qu’elle est l'ennemie qui me veut du bien, le signal d’alarme, l’expression privilégiée de mon organisme au moindre pet de travers. Une des façons qu’elle a de m’envoyer sa carte de visite est d’accentuer encore ma tendance naturelle à la distraction ; cela fait donc des mois que j’additionne les actes manqués et les erreurs, je sais ce que cela veut dire et je tâche d’en prendre acte. (Entre autres hauts faits, j’ai réussi à oublier, en moins d'une semaine, successivement mon téléphone, mon ordinateur, puis mon sac à main tout entier. Même pour moi, c’est un record personnel.) Mais depuis six mois, je constate que tout le monde en fait, des erreurs ; même des gens qui, contrairement à moi, n’en font jamais ; même des gens dont c’est le métier de ne pas en faire. Telle comptable m’envoie les papiers de salaire de quelqu’un d'autre ; tel échange de devis et factures va prendre quatre tours au lieu d’un parce que, toujours, l’un de nous se trompe sur un chiffre ; tel musicien, dont la rigueur et la ponctualité sont du bois dont on fait les légendes, oublie de se rendre à une répé ; tel politicien de longue carrière lâche soudain une remarque à faire douter de ses capacités intellectuelles autant que professionnelles. Les newsletters nous parviennent toutes une deuxième fois avec un erratum ; les articles les plus sérieux paraissent avec une quantité de coquilles et de mauvais copier-coller dépassant largement la normale. Quant à mon impression que, sur la route, les conducteurs font moins attention qu’à l’ordinaire, elle semble hélas confirmée par les chiffres de la sécurité routière. A tort ou à raison, je vois en tout cela la signature de la fatigue, une fatigue cette fois universelle. Nous non plus, nous n’avons, en ce moment, plus assez de monde en nous pour trier nos bagages.
Nous avons déjà passé plus de deux ans dans la lessiveuse de la pandémie ; nous n’en sommes, que cela nous plaise ou non, pas encore sortis. Il s’y est ajouté entre autres le cancer de la guerre en Ukraine, ses suites potentielles incertaines et ses conséquences immédiates déjà immenses. Sans parler de la réalité toujours plus palpable de la démence du climat. Et cependant les activités ont repris, avec cette résilience, cet art de l’oubli de la crise qui est sans doute un des grands talents innés de l’homo sapiens – sauf que, pour l’instant, d’une part nous sommes en train d’oublier des crises qui n’ont rien de terminé ; d’autre part nous sommes en train d’attendre de nous-mêmes de fonctionner comme s’il ne s’était rien passé d'inhabituel. Sortis d’une sorte de coma (et je sais bien que beaucoup d’entre nous ont travaillé comme des brutes pendant ces deux ans ! C’est mon cas aussi – même si cela n’a rien de comparable avec ce qu’ont vécu les soignants ! Mais la gestion de crise, si intense soit-elle, est elle aussi une sorte de parenthèse), nous ne comprenons pas pourquoi tel chantier n’a pas avancé, pourquoi tel dossier d’ordinaire bouclé en avril est toujours en souffrance fin mai, pourquoi nous n’arrivons pas à avancer plus vite sur telle recherche ou telle finalisation. Et comme cette panique est générale, ce sont tous les téléphones qui se mettent à fumer en demandant des réponses pour avant-hier, tous les corps qui peinent parce qu’après deux ans de stress et d’effort pour tenir on leur reproche maintenant de ne pas parvenir à repartir au petit galop, tous les cerveaux qui courent au plus pressé avec des brassées d’informations et, naturellement, en laissent tomber pas mal en route…
Que faire ? L’idéal serait : rien, pendant un moment. Mais pour la plupart d’entre nous, nous n’avons pas ce luxe. Et oui, bien sûr, la balle est avant tout dans le camp de nos dirigeants politiques et économiques, qui se doivent de tenir compte de cet épuisement général (et aussi de passer la main si d’aventure eux-mêmes commencent à flancher) ; à eux de l’entendre, à nous de ne pas les laisser l’oublier. Mais entre nous autres simples mortels, pour ma part, je n’ai rien de mieux à recommander que l’indulgence. Indulgence envers soi-même, indulgence envers autrui – non, « ce n’est pas normal » de commettre telle ou telle erreur, mais c’est ce que nous traversons qui n’est pas normal. Si nous acceptons de pardonner un peu plus des petites complications causées par chacun de nous, peut-être garderons-nous tous un peu plus de l’énergie nécessaire pour éviter les erreurs vraiment graves. Je veux croire que quelqu’un qui craint moins les foudres de sa hiérarchie pour un mail en retard évitera peut-être de causer un accident en tapant un SMS au volant pour dire qu’il arrive. Qu’un salarié d’aéroport avec lequel tous les propriétaires de bagages perdus seront restés polis et rationnels regardera peut-être mieux en traversant la rue le soir… L’indulgence, c’est la tendresse que l’on peut avoir même pour d’autres que ceux qu’on aime. Et s’il y a bien quelque chose dont ce printemps, dont cette époque entière manque, c’est la tendresse. Nous pourrons redevenir des dogues intransigeants le jour où nous aurons tous bien dormi.
(1) Rendons à César le service clients qui lui revient, Air France a traité ma demande de dédommagement en une semaine seulement.