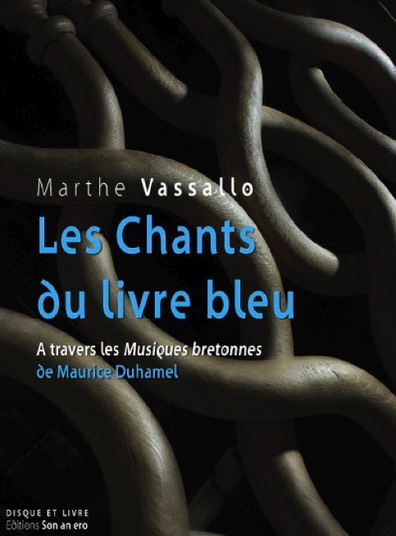Non, je n'ai pas fait de confusion d'orthographe – ou du moins pas cette fois-ci : arrivée au quatrième épisode, je dois bien reconnaître que mes "petits contes" n'ont rien de charmantes histoires et tout de la comptabilité, bilan et prévisionnel. Faire les comptes, c'est précisément ce à quoi la fatigue vous contraint, même si cela peut passer par ces pudiques homophonies dont l'inconscient a le secret.
Quand j'ai dû m'avouer vaincue, l'hiver dernier, je n'ai même pas songé à consulter un médecin. L'arrêt de travail pour autre chose que des fractures multiples ou une maladie mortelle n'existe tout bonnement pas dans l'imaginaire d'un intermittent du spectacle (1). En l'occurrence le diagnostic paraissait clair : avant toute réparation de long terme, j'avais un besoin urgent, viscéral, d'arrêter d'essayer de travailler. Et comme je savais que je n'y parviendrais certainement pas en restant chez moi, je suis allée me réfugier trois jours au milieu des blouses blanches d'opérette d'un centre de thalassothérapie. Là, entre les baignoires à moteur et les curistes en peignoirs beiges comme des robes de bure, j'ai pu commencer à mesurer l'état dans lequel j'étais.
Je n'étais pas vraiment triste – pas de la tristesse de plomb de la dépression. J'étais juste complètement, matériellement vide (2), et tout mon être aspirait violemment à rien : non seulement ne rien faire, mais ne rien voir, ne rien entendre, ne réagir à rien, ne rien recevoir d'extérieur qui relance encore la moulinette dans ma tête, exténuante et exténuée. Au moment de choisir un livre à emporter, même mes Agatha Christie familiers m'avaient paru répugnants de stimulation potentielle, et j'avais fini par prendre un gros livre sur l'architecture gothique dont je n'ai fait, pendant une semaine, que contempler les images au hasard. La seule chose à laquelle je pouvais encore réfléchir était : comment en suis-je arrivée là, et comment en sortir ?
Je pouvais partir d'une constatation : cette inaction, si elle m'effrayait, me faisait du bien. En manquais-je donc tant, moi qui me flagellais de ne pas travailler assez ? Je me suis alors aperçue que j'avais petit à petit cessé à peu près complètement de prendre des jours off. Non que j'aie été si efficace que j'aie réussi à faire de chaque jour une fête de la productivité – bien au contraire, même, à mesure que l'épuisement gagnait du terrain – mais j'en étais venue, imperceptiblement, à considérer que travailler chaque jour était le premier des devoirs. Dans le brouillard un lendemain de concert ? J'écrivais. Dans le train ? L'ordinateur systématiquement ouvert. Une belle journée ? On emporte les partitions sur la plage. Et quand le repos devenait inévitable, ou que la procrastination s'imposait comme seul abri, je culpabilisais. Il fallait que je sois malade pour m'arrêter.
La première règle d'hygiène à adopter, me suis-je donc dit, serait d'instaurer un jour chômé régulier. Pourquoi pas un jour de repos par semaine, que je sois crevée ou non ? La plupart des gens en ont un, voire deux… Je ne m'étais pas sitôt fait cette suggestion que surgissait la réponse :
« Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? »
Et c'est là que j'ai eu vraiment peur. Parce que j'avais toujours tenu pour acquis que ma maison, ma vie, le monde, les mondes petits et grands, étaient pleins de choses étrangères à mon métier et que j'aurais voulu faire. Parce que je rêvais depuis longtemps d'avoir du temps pour traîner chez moi, pour lire, pour regarder passer les nuages, pour marcher. Et voilà que, confrontée à l'éventualité d'un rendez-vous régulier avec ce temps, j'étais désemparée comme si, au fond, rien de tout cela ne m'avait paru valoir ce sacro-saint Travail. J'avais perdu tout sens du loisir.
Il allait donc falloir que ce jour chômé ne soit pas seulement un jour libre ; il ne suffirait pas que le travail n'y soit pas obligatoire, il allait falloir qu'il y soit interdit.
Un jour où il serait interdit de faire quoi que ce soit, un jour pour soi, pour réfléchir à sa vie et non à son chantier, faire le point, respirer, se sentir au monde, profiter des belles choses… Hum, j'ai déjà entendu ça quelque part.
C'est ainsi que, en peignoir de moine franciscain décadent, sur un transat face à l'île de Batz, j'ai réinventé l'eau chaude – en l'occurrence le concept du Shabbat.
Le Shabbat, pour ceux qui l'ignoreraient, c'est le jour de repos juif dont dérive notre dimanche (je ne connais pas l'historique du vendredi de prière des musulmans, mais je note son existence et son caractère lui aussi hebdomadaire). Pour autant que j'aie compris, durant vingt-quatre heures il est interdit de produire ni créer quoi que ce soit. Oh, je ne pousserai sûrement jamais aussi loin que cette parente, juive convertie, qu'il ne faut pas appeler au téléphone entre vendredi et samedi soir. Mais vous ne pouvez pas savoir comme cette idée de ne rien créer un jour par semaine peut être attirante pour une artiste au bout du rouleau… Il y a une chanson du répertoire des frères Morvan, qu'Annie Ebrel chante sur l'album Teir d'Ebrel/Le Buhé/Vassallo, et où une ménagère qui veut mordicus faire du beurre le jour de la fête de la Vierge se retrouve à baratter, baratter sans fin, à s'en rendre gravement malade, sans que sa crème prenne. La chanson est bien tournée, avec des images fortes et une belle mélodie, mais j'ai longtemps grincé des dents sur ce qui me semblait une bondieuserie. C'en est bel et bien une ! Mais j'entends d'une tout autre oreille, désormais, cette histoire de quelqu'un qui s'épuise à vouloir produire quelque chose quand elle devrait se reposer.
Dans Ces gens du Moyen-Age, Robert Fossier rappelle que la vie d'un paysan médiéval, que l'on imagine entièrement consumée par travaux et corvées, était en réalité rythmée par le calendrier religieux au point qu'une part importante de l'année (plus d'un quart, je crois) était fériée. C'est le XIXe siècle industriel, pourtant si bigot, qui a considéré que le travailleur était corvéable dix à quatorze heures par jour et six à sept jours sur sept, avant que, horriblement lentement, la loi ne vienne limiter ce cannibalisme. Evidemment, ni les fêtes religieuses du Moyen-Age, ni un rigoureux Shabbat juif ou dimanche chrétien, n'ont grand chose à voir avec le loisir auquel j'aspirais. Dans sa fonction historique de régulation sociale, la religion encadre et récupère le repos et la réflexion comme tout autre aspect de la vie individuelle et collective. Reste qu'il n'en est pas moins remarquable, précisément, que l'Ancien Testament ait inscrit la nécessité de marquer une pause après l'œuvre dès la Genèse, dans la matière même des temps et du monde, et dès les premières lignes de son récit. De fort laïques pratiques de méditation, aujourd'hui, mettent l'accent sur le petit temps de suspension qui, dans le cycle respiratoire au cœur de leur observation, relie l'inspir et l'expir. Le repos obligatoire des religions peut n'être vu que comme une gestion pragmatique des ressources humaines ; mais cette sacralisation superlative de la récupération après la production – c'est, exemple suprême, le Créateur en personne qui se repose, et fait du jour de son repos un jour sacré ! – révèle à quel point elles avaient conscience là d'un besoin vital, organique, au plus profond du vivant, qu'elles se devaient de canaliser.
Et à plus séculière échelle, pour une petite chanteuse en 2014, comment faire, entre le pic de concerts du week-end et les partenaires professionnels qui ont, eux, des semaines du lundi au vendredi ? (Je trouve tristement révélateur le fait que nombre de mes collègues, quand je leur ai fait part de ma réflexion, ont immédiatement répondu "houla, difficile…") J'en suis encore à la mise au point, mais j'ai instauré un "dimanche" mobile, reportable et cumulable en cas d'impossibilité. Je le marque sur le calendrier, et je tâche de respecter autant que possible ma propre consigne : aucune activité prévue ni obligatoire, et travail professionnel interdit – même lire une biographie de compositeur. Et surtout je tâche de rester à distance de l'ordinateur…
Ce n'est pas toujours une brillante réussite, et peu importe. L'essentiel est de maintenir un espace où peut exister autre chose que travail et devoir ; de maintenir cette ouverture régulière de fenêtre.
Fenêtre par laquelle, outre l'air frais, bien des images, des parfums et des oiseaux peuvent tôt ou tard entrer. L'ironie de toute cette histoire est que je sais depuis fort longtemps que, outre le besoin naturel de repos, dans un travail créatif le loisir et son errance sont des nourritures essentielles, sans lesquelles on se met tôt ou tard à manquer tout bonnement de choses à raconter autant que de moyens de le faire. J'avais juste complètement perdu de vue, en pratique, cette règle de base. Tellement de base que les grands monothéismes en font l'axe de leur pratique depuis des siècles et des siècles (non sans surveiller étroitement, eux, ce qui entre par la fenêtre !)… Pour une mécréante qui se croit raisonnablement libre, c'est un rien dur à avaler – et cependant poétiquement satisfaisant, comme l'impression d'une petite miette de compréhension nouvelle.
(1) A la fois parce que l'arrêt maladie est la garantie de tracas administratifs qui viennent s'ajouter à la maladie initiale, et parce que nous avons, chevillé au corps, le culte de l'engagement à tenir – Molière mourant en scène, ze show must go on e tutti quanti, quand ce n'est pas cette réalité que si nous n'allons pas travailler, entre deux et quinze personnes ne travailleront pas non plus… A ce sujet, j'aimerais que, chaque fois que quelqu'un clame que nous coûtons des sommes importantes à l'Unedic, il ait une petite pensée pour les sommes que nous ne coûtons PAS à la Sécurité Sociale, précisément en ne demandant jamais d'arrêt maladie à la légère…
(2) le concept même de "burn-out" a été inspiré par l'image d'un immeuble incendié, façade intacte mais intérieur anéanti, comme une coque vide.