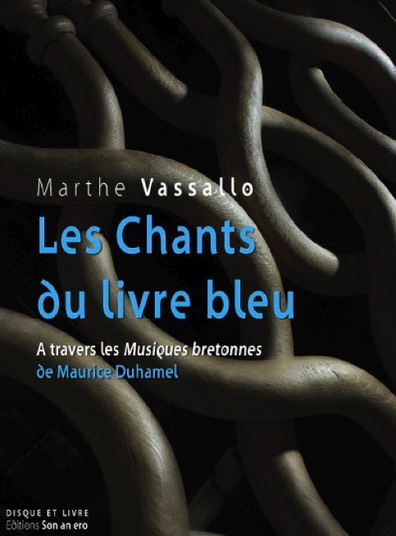Inconditionnels de la simplicité, passez votre chemin. (De toute façon, que diantre faites-vous ici ?) A l’heure où la lumière change de couleur, où les talus se chargent de mûres qu’on peut manger sans plisser les yeux et où les supermarchés essaient de nous fourguer les meubles d’étudiants après les cahiers et les gommes, j’essaie de faire le bilan de cet été pas comme les autres, et… disons que c’est coton.
D’habitude, pas de problème : un artiste, sur internet, va toujours extrêmement bien. Soit il joue, ô félicité, soit il ne joue pas et c’est qu’il est en préparations pour jouer, ô bonheur. (Et ce même si son fonds de commerce consiste à chanter à la première personne à quel point il est irrémédiablement seul et malheureux.)
L’année 2020 a imprimé une torsion violente à ce principe comme à tout le reste : tout humour mis à part, le monde du spectacle n’est pour l'instant qu’un champ de ruines fumantes, et même l’évaluation des dégâts est encore impossible tant la visibilité est réduite. Les répercutions se feront sûrement sentir très longtemps après que la pandémie soit calmée – sous forme de faillites, de dégradation de certains standards (par exemple, si les boîtes de sono mettent la clef sous la porte faute de travail et d'aide, cela ne sera pas sans répercution sur la qualité des concerts futurs, donc sur ce que les musiciens pourront faire ou ne pas faire, pendant un bon moment ; le niveau du matériel et des techniciens que nous avons en Bretagne n’est pas un don du Saint Esprit), d’effondrement possible de certains réseaux, de perte d’élan après l’avortement de créations et de débuts de carrière, et j’en passe – ne parlons même pas des baisses de budgets culturels qui ne sauraient manquer de nous tomber sur le râble. En France, la prolongation des allocations chômage des intermittents du spectacle a donné de l’air à ceux d’entre nous qui en bénéficiaient – j’en suis, et il est bien vrai que je respire un peu mieux depuis. Mais la bulle d’oxygène, nous le savons, n’est que temporaire.
Et en même temps, j’ai chanté presque tout cet été.
Je suis loin d’être la seule, et cependant j’ai aussi nombre de collègues, et non des moins reconnus, qui n’ont joué qu’une ou deux fois depuis six mois.
A partir du mois de juin, à mesure que l’on s’apercevait que la deuxième vague tant redoutée ne semblait pas prête à déferler, à mesure qu’il est devenu envisageable de partir en vacances et que les mairies s’apercevaient qu’elles n’avaient plus d’offre culturelle pour ces désormais probables touristes, à mesure que les associations en deuil de leurs festivals commençaient à mieux voir les contours de petits évènements alternatifs qu’il serait peut-être possible de monter quand même, mon téléphone s’est mis à sonner.
Pourquoi le mien et celui de certains collègues, et pas celui de Pierre, Paul ou Jacqueline ? Difficile à dire. Dans mon cas, je suppose qu’entre « Maryvonne La Grande » et les nombreuses fois où on a pu me voir faire des choses incongrues au fond des bois pour des balades musicales toujours plus ou moins improvisées, je suis identifiée comme quelqu’un qui sait travailler en solo, en acoustique, en plein air et en adaptation rapide. (Le mot-clef, ici, est « identifiée » ; j’ai des collègues au moins aussi compétents que moi pour ce genre de sport, mais qui ne sont hélas pas connus des services sous cette casquette-là.) Comme une grande gueule, peut-être aussi, et il faut en être une pour ce genre d’évènement ; peut-être enfin comme quelqu’un capable de flexibilité sur les conditions physiques et financières ? Je l’ignore. En tout cas je suis passée en quelques semaines d’un calendrier estival couvert de ratures et mouillé de mes larmes à un nouvel agenda renoirci et trempé de sueur – quoique hérissé de points d’interrogation, pour certains levés le jour même du spectacle. De plan B en plan B, j’ai fini par ne plus relever le nez du guidon, d’autant que chacune ou presque de ces nouvelles dates supposait répétitions, repérages et autres recherches.
Je suis donc, à l’heure qu’il est, dans un état de fatigue qui n’a rien à envier à une fin août normale où j’aurais surfé de fest-noz en festival. Et bien entendu, je n’imaginerais pas de m’en plaindre – sinon au Créateur pour ne pas m’avoir donné des stocks inépuisables de résistance physique et nerveuse, mais c’est une autre histoire. Avoir eu beaucoup de spectacles en cet été 2020 est, avant et après tout, une immense chance, que je n’osais pas espérer en avril. Que cette chance se paie de beaucoup de travail passé et présent n’en fait pas moins une chance, et je ne sais que trop bien que tous mes camarades ne l’ont pas eue.
A présent, en route pour l’automne. Il s’annonce tout aussi étrange et imprévisible, il compte déjà plusieurs reports à l’an prochain, dont celui d'une production de trois semaines. Nul doute que d’autres suivront. En même temps, certaines options plus récentes, déjà façonnées aux contours des règles sanitaires prévisibles, pourraient tenir la marée ? Qui vivra verra.
« Qui vivra verra » pourrait sembler, de toute façon, le slogan du monde de la culture depuis le début de la pandémie. La projection est devenue futile : tantôt les craintes apocalyptiques s’avèrent infondées, tantôt tout ce qui nous faisait nous exclamer « on ne va tout même pas… » le lundi devient réglementaire le vendredi. Le résultat est une telle instabilité qu’en réalité, « qui vivra verra » devient inexact : même qui a vécu n’est jamais tout à fait sûr de ce qu’il a vu.
Cet été, j’en ai vécu, des choses, mais comment les décrire ? À quelle aune les mesurer ? Le plus souvent, j’ai chanté en acoustique, en plein air, pour un public limité par le nombre de places disponibles. On peut se réjouir que les gens aient fait montre d’une telle fringale de spectacles et de concerts que nous avons tous joué à guichet fermés tout l’été ; on peut pleurer que tout ait été si vite complet parce que les limites étaient drastiques. On aura raison dans les deux cas. Je peux estimer que le chant a capella, souvent solo, face au public, sans les effets de la scène et de la sonorisation, et même sans les vapeurs de la fête, représentait un passionnant retour à l’essentiel (que je n’avais de toute façon pas attendu le virus pour m'offrir) ; je peux aussi remarquer que, bon sang de bon soir, à haute dose, ça tirait fort sur la voix et sur le cuir de la bête : le plein air, le solo, l’acoustique, le déambulatoire, le public pas forcément venu pour vous, tout cela sollicite votre réactivité et votre simple force physique. Là encore, aucune de ces deux lectures n’est moins vraie que l’autre.
La majeure partie de ce que j’ai fait cet été peut se regarder de cette double façon : comme une résilience exaltante, la force irréfutable de ce qui a été, et comme la marque de tout ce qui manquait, le révélateur de ce qui n’était pas. A tel endroit, c’était le savoureux dispositif de service à table organisé par l’asso qui mettait aussi en valeur l’interdiction de l’habituelle buvette en folie, et de toute la planète en riboule autour ; dans telle ville de festival où l’on se rendait pour un évènement « de rattrapage », c’était la vision du site habituel dépouillé de ses chapiteaux et de ses lumières, comme si la marraine fée avait perdu ses pouvoirs – comme si, au lieu de vivre un cauchemar, nous découvrions que c’est jusqu’ici que nous vivions dans un rêve.
Je pense qu’il est vain de se demander s’il faut, in fine, choisir une des deux visions : se réjouir de ce qui a été fait, de toute la beauté suscitée in extremis, en face à face, avec des bouts de ficelle, ou déplorer les fêtes et les grands partages perdus, et qu’il ait fallu des bouts de ficelle ; être reconnaissant d’avoir pu travailler, ou avoir le cœur fendu pour les collègues qui n’en ont pas eu l’opportunité. Il n’y a sans doute d’autre choix que de ressentir les deux à la fois, sans résolution possible. Cette espèce d’ambivalence que je traîne ces jours-ci ne signifie peut-être pas que mon cerveau n’arrive pas à terminer sa tâche de traitement, mais bien qu’il la termine, jour après jour, et que sa conclusion est que chercher à trancher n’aurait aucun sens. De même, parmi ceux qui ont eu peu ou pas d’occasions de jouer, certains disaient aussi les bienfaits, malgré tout, de faire enfin une pause auprès des leurs, ou de pouvoir se consacrer à des travaux de fond longtemps repoussés ; pour ma part, en cet été d’immédiateté, je n’ai rien vu du soleil et pas grand-chose des miens, mon jardin est à l’abandon, mes pattes flageolantes et mes chantiers au long cours pleins de toiles d'araignée ; mais je pense qu’il est parfaitement stérile de chercher à déterminer lequel de nous est enviable, comme si la survenue d’une pandémie nous obligeait soudainement à pontifier sur ce qui, dans une vie, vaut ou non d’être vécu. À décider précisément de ce que nous voulons, pour toujours, alors même que notre marge d’action est plus limitée et son évolution plus imprévisible que jamais – et surtout à prononcer ce jugement non seulement pour nous-même mais pour autrui.
J'espère parvenir, dans un autre courrier, à réunir quelques images (en mots, s’entend – je n’avais pas le temps de faire des photos !) de cet été sens dessus dessous, quelques instantanés de la façon qu’il a eu d’être unique. J’en retiens en tout cas une chose, sans ambiguité, elle : jour après jour, dans l’accueil fait aux concerts – les miens comme ceux des autres –, dans les discussions que j’ai pu avoir au détour d’une rue ou suivre sur Internet, dans la façon dont les réservations venaient vite et nombreuses, s’exprimait votre faim de musique et de spectacle. Amis auditeurs et spectateurs, vous me pardonnerez, j’espère, de trouver rassérénante l’idée que la scène vous manque autant qu’à nous, et que vous avez autant besoin que nous de voler des minutes de partage et d’intensité à l’éteignoir qui nous obscurcit le ciel.