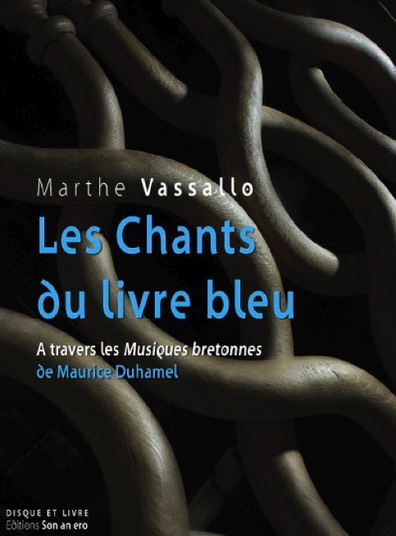La une de Courrier International, cette semaine, est toute rouge. Une demoiselle flotte sur un océan carmin, confortablement étendue sur un matelas en forme de serviette hygiénique à ailettes, et son maillot ressemble fort à une petite, élégante tachounette de sang sur ladite serviette (mais du sang clair, frais et limpide, hein, on ne veut pas trop effrayer le chaland tout de même). « Règles, la fin du tabou », proclame le titre. A l’intérieur, un extrait d’un dossier paru dans Newsweek. On y apprendra plein de choses sur la difficulté d’accès aux protections dans le monde, les variations locales de la condamnation du sang menstruel, les taxes injustifiables que nous avons toutes payées sur nos serviettes et tampons, considérés comme des produits de luxe par des législateurs dont l’unique point commun était de ne jamais en avoir eu la nécessité – et de n’avoir eu pour compagnes, je suppose, que des femmes qui n’avaient pas besoin de comparer les prix au rayon « hygiène féminine ».
« Il y a vraiment un tabou sur les règles ? me demande benoîtement mon compagnon en ouvrant le Courrier.
– Oh oui, et c’est ce que tu trouveras détaillé dans l’article, réponds-je.
– Oui, bon, dans d’autres pays, d’accord. Mais ici ? Je n’ai pas l’impression. (Mon compagnon appartient à la minorité bénie des gens que l'idée des règles ne fait pas blémir. Pas pour rien que c’est mon compagnon.)
– Bien sûr que si ! Celui qui nous fait déployer des ruses de sioux pour cacher nos serviettes dans nos sacs à main. Celui qui fait que jamais une femme ne dira « désolée, je ne peux pas venir, j’ai atrocement mal au ventre ». Celui que quelques sportives ont brisé récemment en annonçant que leurs règles avaient entravé leur performance.
– Mais pourquoi vous ne le dites jamais, au fait ? Plus précisément, pourquoi les féministes n’en ont-elles jamais parlé jusqu’ici ?
– Parce que, je suppose, c’était à double tranchant : demander la reconnaissance des douleurs et autres handicaps liés aux règles, c’était reconnaître une source de faiblesse propre aux femmes. Ça ne cadrait pas avec l’exigence d’égalité. Mais c’est aussi parce qu’on se tait qu’on a toujours si peu de vraies études sur le phénomène, et toujours pas de traitement pour tout le monde… »
Et c’est vrai : demandez à Google, vous verrez qu’on estime qu’un bon quart des femmes en âge de procréer souffre de douleurs handicapantes, et qu’une large majorité connaît cette souffrance à un degré moindre, mais ce n’est là qu’un estimatif. Et s’il existe des traitements, aucun n’est complet : les antidouleurs ne marchent que quelques heures, vous grignotent l’estomac et perdent en efficacité avec le temps (sans compter qu’il faut encore réussir à les digérer, des douleurs intenses pouvant aussi susciter des nausées) ; la pilule et autres approches hormonales, tant vantées par les gynécos, ne soulagent pas toutes les patientes et peuvent en changer une petite minorité en Bibendum suicidaire et menacé d’infarctus (testé pour vous dans ma prime jeunesse). Nous sommes au moins des centaines de millions à en baver des ronds de chapeau au moins une semaine sur quatre, mais notre souffrance n’est pas prise au sérieux au point de susciter ne serait-ce qu’une vaste étude statistique, sans parler d’une recherche approfondie sur les causes et les traitements. « Les femmes n’ont rien demandé », se défendent en substance les laboratoires, comme l’ont fait les législateurs à propos des taxes. Eh bien, il est temps que ça change. Il est temps de demander. « Les hommes parlent bien de leurs problèmes de prostate », commente mon amoureux…
Considérez donc ceci comme mon coming-out. Je ne suis pas sûre de vouloir « briser le tabou » en me promenant robe tachée au vent ; je n’ai pas plus envie de vous tenir au courant de ce qui sort par celui-là de mes orifices que de ce qui s’évacue par les autres. La pudeur personnelle et l’intimité ne sont pas moins nobles causes que la liberté, qui devrait les englober. Mais s’il faut en passer par là pour que les choses bougent, alors je le dis haut et fort : comptez-moi dans la colonne infinie des femmes en pleine santé qui se bagarrent néanmoins, à peu près la moitié du mois (ah oui, parce qu’il n’y a pas que le moment des règles !), avec les conséquences « naturelles » de cette même santé. Elles sont naturelles, voui, comme vos soucis d’érection, de prostate et de choléstérol, messieurs, et cependant on s’escrime à trouver des solutions à ces problèmes-là.
Je suis d’âge assez canonique pour avoir été pubère quelques années avant l’arrivée de l’ibuprofène dans nos pharmacies. Je ne sais pas ce que serait ma vie sans cette molécule, si imparfaite soit-elle. A l’époque, je passais plusieurs jours par mois à l’état de petite loque humaine gémissante et tremblante, vomissant tripes et boyaux (et avec eux le pieux et inefficace Doliprane des infirmières scolaires), le dos scié en même temps que le ventre. Ma grande sœur rapporta des Etats-Unis un flacon de la molécule magique, et tout d’un coup il devint possible de vivre, de marcher, de penser ces jours-là, et le territoire de la douleur recula jusqu’à de « simples » crises d’une heure, toujours aussi intenses mais que l’imminence du soulagement rendait plus facile à endurer. Je pèse mes mots : l’ibuprofène m’a rendu au moins un sixième de ma vie. Mais… mais avec le temps, il m’a fallu augmenter les doses et l’efficacité n’est plus aussi totale ; mais je suis toujours réveillée par la douleur au milieu de la nuit, une fois passées les trois ou quatre heures d’action de la molécule ; mais est-il normal que trente ans plus tard on n’ait rien de mieux à nous proposer (1) ?
Si vous êtes membre du corps médical, vous serez sûrement tenté de me dire « si vous souffrez à ce point, il doit y avoir un autre problème que l’on pourrait traiter ». Eh bien non, des clous. Je n’ai pas de muqueuse baladeuse, ni de kyste qui se désiste, ni de glande qui débande, je suis absolument bonne pour le service à cet étage-là. J’ai seulement tiré un ticket salement perdant à la grande loterie. ET JE NE SUIS PAS LA SEULE. Du tout. (Vraiment pourrie, cette loterie ; que fait la répression des fraudes ?) Et, tant que je vous tiens, ami soignant : je voudrais tant que vous preniez en compte le fait que vos patientes sont très, très différentes les unes des autres. Que vous m’écoutiez quand, par exemple, je m’échine à vous dire que j’ai essayé tous les types de pilule, qu’elles ne changeaient rien à la douleur mais m’avaient causé à peu près tous les effets secondaires listés dans leurs notices. Je suis ravie que la pilule soit parfaite pour tant de femmes et je suis prête à me battre pour qu’elle leur reste accessible, mais cela vous tuerait-il de me croire quand je vous dis qu’un nouvel essai me tente, moi, à peu près autant qu’une partie de roulette russe ? Je voudrais que vous écoutiez tout court, par exemple en fac de médecine le jour où l’on dit – mais vous le dit-on seulement ? – qu’une partie des femmes ressent aussi à l’ovulation des douleurs non négligeables. Je n’oublierai jamais le jeune généraliste qui m’a soutenu mordicus que je ne pouvais pas connaître ma date de ponte. Mais si, Docteur, vous aussi, si vous aviez une fois par mois depuis vos quatorze ans l’impression qu’un plombier zélé essaie de vous déboulonner l'appendice à la clef à molette, vous le sauriez.
Tout ceci étant dit, nous devons faire très attention à ce que nous demandons : si je me mets à réclamer qu’on tienne pour certain que toute femme peut avoir les mêmes problèmes que moi, j’associe de facto la féminité à une faiblesse potentielle, et j’apporte un bon baquet d’eau à l'odieux moulin de ceux qui rêvent d’une société où les « vrais hommes » et les « vraies femmes » seraient à leur « vraie place ». (Soit dit en passant, dois-je seulement préciser qu’avoir ses règles n’est pas la condition sine qua non de la féminité ?) Je ne veux pas qu’on se contente de me reconnaître le droit de souffrir, je veux l'exact inverse : qu’au nom de l’égalité on reconnaisse que les femmes ont, autant que les hommes, le droit de ne pas souffrir. Même quand l’origine de leur souffrance n’est pas une maladie. Que les chercheurs cherchent ! Que les soignants soignent ! Et que d’ici là, à des collègues assez proches pour pouvoir entendre « désolé, je suis patraque, j’ai mangé un truc qui ne passe pas », il soit aussi possible de dire « désolée, j’ai mal au ventre, je ne peux pas conduire pour l'instant, j’arrive dans une heure ». Et qu’il soit entendu que ça ne nous rend pas inefficaces ni faiblardes une fois cette heure passée. Qu’il soit même reconnu que nous sommes plutôt, pour avancer avec ce poids-là, de sacrées costaudes. (Il me semble que Florence Arthaud, grande pionnière s’il en fut, avait abordé la question au retour d’une grande course.) Quant aux sautes d’humeur dont beaucoup d’entre nous sont familières, elles ne nous rendent pas moins fiables, elles nous ont appris, au contraire, à nous méfier de notre seule perception du moment – une leçon qui profiterait à bien des messieurs.
Le temps que nous arrivions à faire bouger les choses sur tous ces fronts, je n’aurai probablement plus l’usage de serviettes ni d’ibuprofène. C’est donc en pensant aux fillettes d’aujourd’hui que j’espère que nous serons nombreuses, nous que les années ont en principe guéries du souhait de passer pour des fleurs immaculées et dépourvues de fonctions corporelles, à cesser de nous taire et à exiger notre dû d’attention et d'égalité. Je sais que les progrès ne se feront pas en un jour ; j’espère seulement les voir advenir avant d’en être, pour ma part, au point de ma vie où c’est de couches que j’aurai besoin.
(1) On m’a un jour fait essayer une autre molécule en -fène, plus forte mais aggressive au point qu’il fallait impérativement la prendre au milieu d’un repas. Aimable blague : le matin, cela laissait tout le temps à la douleur et aux nausées de s’installer si bien que c’est à peine si je suis jamais parvenue à prendre le comprimé… Efficace sur le papier, ce médicament était royalement inadapté à la problématique réelle.