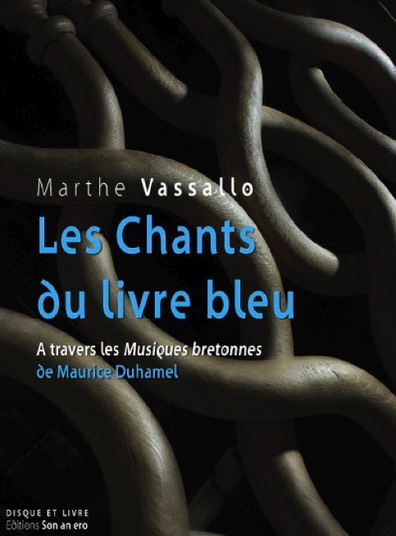La concierge va ajouter sa plume à toutes celles qui, depuis deux siècles, écrivent en français à propos du breton, puisque le peu qu’elle va dire concerne autant les non-locuteurs que les autres : face au ramdam actuel, pour le moment, la concierge a décidé… de ne rien dire.
Ce n’est pas que je n’aie rien à raconter… C’est l’inverse. Il y a tant, tant de choses à dire. Tant de choses qui ne rentrent pas dans un confetti de réseau social, dans un discours électoral, dans un panneau de manif.
J’y étais, à la manif du 29 mai, si jamais vous vous posez la question. J’y suis allée discrètement, en petite piétonne, parce que, si bien souvent la tendance au simplisme des discours de défense du breton me pousse à m'abstenir, cette fois le simplisme outrancier et le nationalisme bêta étaient du côté du Conseil Constitutionnel, et ce n’est pas la première fois. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir eu cette pensée.
Non, si je ne dis rien, c’est pour une raison tout bête : je n’ai pas le temps de dire tout ce que je ressens qu’il faudrait dire. Il faudrait écrire un livre, et j’ai des engagements de chanteuse à tenir, tout simplement. Je refuse que ma qualité de bretonnante, et même de chanteuse bretonnante, m’oblige à exprimer une doctrine sur le breton ; et je n’ai pas envie de réduire à un slogan toute la complexité de ce que je vis. Tous les moments qu’il faudrait raconter : instants de désespoir devant la dégradation de qualité de la langue parlée par beaucoup de gens, dont moi ; instants de plaisir à échanger inopinément avec quelqu’un – pas plus tard qu’il y a deux jours, un petit gars venu me vendre un billet de tombola – ; instants d’agacement devant la manie de la traduction systématique et symbolique (si vous suivez mon boulot, vous savez déjà que je refuse de dire la même chose dans deux langues, et que les symboles ne sont pas ma tasse de thé), comme devant les clichés au ras des pâquerettes que j’entends encore souvent de la part de gens qui débarquent d’ailleurs, et comme devant l’idéalisation du pouvoir d’une langue, si à la mode en ce moment et dont l’écriture inclusive est un avatar – croyance que c’est définitivement l’œuf qui fait la poule, et jamais le contraire. Instants de joie amicale autour d’un bol de café. Instants de douceur à passer fluidement d’une langue à l’autre. Découragement à voir comment certains enseignent sans couleur une langue apprise sans joie – puis regonflement à en voir d’autres faire un travail de partage profond et plein de vie, en pleine fluidité avec ce qui était là avant nous (impossible de taper ceci sans adresser un salut à Yannig Audran, instit Diwan et musicien, dont le travail dans les deux domaines m’avait fait venir les larmes aux yeux, parti terriblement trop tôt). Re-découragement lorsque tel ancien se montre mal à l’aise à vous parler, ou que vous en bavez à faire une transcription de collectage ; re-regonflement quand le frère de l'ancien, lui, engage la conversation avec enthousiasme. Et bien sûr, la plongée d’une vie dans les histoires chantées et racontées, avec ses coulées vertigineuses et ses rochers sur lesquels on laisse de la peau et du sang. Tristesse de devoir regarder en face l’inutilité foncière d’une langue minoritaire ; certitude pourtant, toute bête, d’avoir vécu des choses que je n'aurais pas vécues si je n’avais pas parlé breton – à commencer par une bonne partie de ma vie de chanteuse, mais pas seulement. Des choses bonnes et mauvaises. Des choses dues au militantisme parfois – que j’en approuve les racines, ou qu’elles me donnent la nausée – et parfois pas du tout. Parfois un peu des deux.
C’est ça qui me manque dans les passes d’armes actuelles : une fois de plus, c’est comme si aucune place n'était faite à la contradiction interne, naturelle. Comme si elle n’était pas dans la nature humaine. Je vis, autour du breton, des choses tristes et gaies, belles et moches, des choses qui sonnent le creux et d’autres qui regorgent de richesse. Et le nœud de l’affaire, c’est que je ne peux pas prévoir à l’avance où seront les unes et les autres. C’est cela qui me fait continuer – cela, et mon amour pour ces histoires, ces mots, ces sons, ces tournures (même si je n’en possède pas la moitié de ce que je voudrais), mon admiration et ma tendresse pour les personnes qui les ont portées jusqu’à nous, mon désir que le plus possible de gens puissent les comprendre et les faire circuler demain. L’avenir n’est pas rose, mais je ne vois pas de raison d’arrêter d’essayer de partager ce que j’aime – même si « partager ce que j’aime » peut parfois signifier être en opposition à certains défenseurs du breton. Et même si j’irai à ma tombe (tiens, un anglicisme !) en soutenant que parler une langue ou connaître une culture ne donne aucun devoir de les défendre, pas même de les pratiquer. Partager ce que j’aime, tant que je suis là… Ce qui se passera ensuite n’est pas de mon ressort.
Parler deux langues sur un même territoire est en soi une contradiction. Il n’y a tout simplement aucune solution pour que ce ne le soit pas. J’entends s’écharper les gens autour de moi comme s’il fallait absolument que cela cesse de l’être, d’une façon ou d’une autre, tu pe du, comme si notre vie de bretonnants ne consistait pas, au contraire, à ressentir les plaisirs et les douleurs du paradoxe ; à essayer de le démêler là où il nous mène à l’absurdité, et à continuer à le vivre là où il est vivable et fécond – parce que bien souvent il l'est. Le problème ne serait-il pas que nous demandons trop souvent au breton d’être une solution à quelque chose dans nos vies qui n’est pas de son ressort, que nous attendons de lui qu’il simplifie les choses, quand dans notre monde il ne peut que complexifier ? (Soit dit en passant, je salue André Markowicz qui a, avec son courage habituel, essayé d’exposer posément, sur son fil Facebook, un point de vue parfaitement légitime, en partie partagé par beaucoup d’entre nous, et en partie né de son expérience individuelle, respectable en tant que telle. La violence de certaines réactions à son texte fait partie des choses dont j’ignore si le plus désespérant est que globalement elles ne me surprennent pas, ou qu’au contraire certaines parviennent encore à me faire lever le sourcil… Je l’ai déjà dit, je le réitère : on peut être en désaccord avec ce que disent André Markowicz et Françoise Morvan, moi-même cela m’arrive régulièrement, y compris sur certains points du texte en question ! Mais la violence avec laquelle certaines voix clament que ces deux auteurs n’ont pas le droit de s’exprimer est le signe même qu’ils n’ont pas tort… et la raison première de mon propre soutien de longue date.)
Voilà. Voilà les seules choses que j’aie le temps d’effleurer. Voilà pourquoi je n’ai pas eu envie d’afficher quoi que ce soit sur le maigre judas de ma page Facebook, ni dans le dialogue de sourds des commentaires. (Et oui, bien sûr, écrire ici est aussi ajouter une voix sans oreilles au bruit ambiant ! Mais au moins de façon consciente, et en prenant un temps que les réseaux sociaux n’offrent pas.)
Si, peut-être une dernière chose encore : je suis souvent frappée de la façon dont notre point de vue sur la langue et la culture bretonne sont influencés par le point où nous en sommes dans notre vie – où nous nous sentons dans le cours des générations, quelle expérience nous avons de la disparition des mondes. (Il y a aussi de grandes divergences jamais analysées entre l’angle de vue des clampins doués pour les langues, comme votre servante – en réalité, mes journées se passent en trois langues, voire plus les jours de festin –, et celui de ceux pour qui l’apprentissage ou le développement du breton représente un effort sans équivalent.) Là aussi, il y a un aspect de la simple vie humaine, dont le poids sur nos ressentis respectifs n’est pratiquement jamais pris en compte. Là aussi, il y aurait de grandes et longues discussions à avoir, en chair et en os, et avec la plus grande bienveillance pour la perspective d’autrui. Nous en avons, de ces discussions à cœur ouvert, entre chanteurs, et elles font un bien fou. Serait-il possible d’en organiser à une échelle plus vaste ? Que je n’en sois pas sûre est peut-être la phrase la plus triste de tout ce texte.