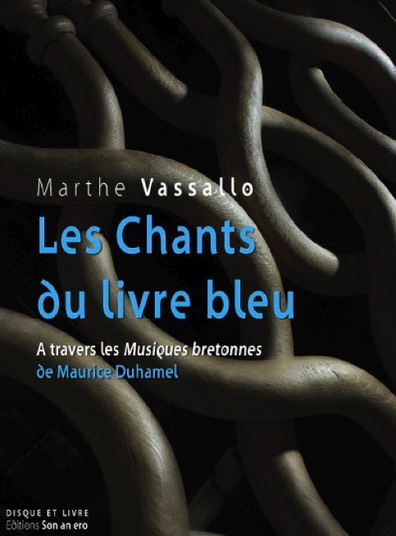La peinture coûtait cher, et Germaine et François n’en avaient plus que de petits restes de diverses couleurs. C’est pourquoi plusieurs des nouvelles pièces de la maison s’ornèrent de décors minimalistes : nuages ombrés de traits pour la petite chambre, poissons en lignes souples pour la salle de bains et, dans l’angle de la cuisine, pois rouges, jaunes, bleus et verts – ou bleu plus foncé ? Difficile à dire aujourd’hui.
La maison était celle des grands-parents maternels de François, et il en avait des souvenirs fondateurs d’éveil à la nature et au temps de la vie. Dans ces années d’après-guerre, les quinze kilomètres qui la séparaient de Niort étaient un océan géographique et social, et lui et sa femme passaient pour de doux givrés de consacrer argent et énergie à rénover cette maison de village ; quand ils quittèrent la ville pour s’y installer, j’imagine que leur cas fut jugé sans appel par un certain nombre de leurs pairs.
Chaque fois qu’une pièce était terminée, ils y passaient une nuit, m’a raconté Germaine. S’ils ne dormaient pas bien, c’est qu’il y avait encore du travail.
« La vie avec lui était passionnante », m’a-t-elle aussi dit un jour. Il était soupe-au-lait – s’énervant lui-même jusqu’à de brusques orages à la cantonnade –, le cœur sans doute un peu trop grand pour ne pas être déçu par la vie et les gens, mais il portait partout un besoin viscéral de faire quelque chose de ses dix doigts comme de sa tête : apprendre, sculpter, enseigner, bâtir, nager, partager, regarder, écouter – la rivière, Shakespeare, les légendes du coin, les vers luisants. Qu’il ait rénové la maison de ses mains devait autant à sa fringale de construction et d'autonomie qu’à la nécessité économique – même s’il faut reconnaître qu’il était meilleur plasticien que plombier. S’étant mis à la sculpture, gamin, parce qu’un professeur lui avait dit « je vois bien qu’il vous faut vous occuper les mains ; dorénavant, venez à mon cours avec un bout de bois et un couteau, ça vous évitera de martyriser votre table », il devint lui-même un professeur d’anglais anticonformiste. L’histoire ne dit pas si ses élèves repartaient avec de meilleures compétences linguistiques que les autres, mais ils furent plusieurs à nous dire qu’ils retenaient de ses cours un sens nouveau de la liberté et de l’accessibilité de la connaissance.
La maison était l’équivalent poitevin de ces bâtisses XIXe qu’on trouve aussi en Bretagne : deux pièces en bas, l’escalier au milieu, et assez d’espace pour deux pièces en haut, même s’il semble qu’à l’origine l’étage ait servi de grenier. Ses dimensions modestes interdisant de la grignoter par l’intérieur, François lui adjoignit des extensions pour le confort moderne : une chambrette supplémentaire, qui servit à sa belle-mère dont je porte le prénom, fut bâtie en petites pierres de calcaire local, puis il découvrit les joies du parpaing et s’en servit pour la cuisine et la salle de bain, sous un toit de tôle et de plastique translucide, tout comme son grand atelier à l'écart. Le résultat, s’il n’eût pas brillé par l’esthétique sans le jardin qui faisait écran, fit l’affaire pendant plus de soixante ans : après avoir abrité sa propre éducation à la beauté de l’existence, la maison couva celle de ses petits-enfants. Entre baignades à la rivière – il avait acheté, avec des amis, le champ qui servait de plage à tout le village, dans le seul but de le laisser ouvert à tous – et après-midi paresseux, odeurs du foin (pour les lapins) et des coffres à grain (pour la basse-cour pantagruélique où même les canards col-vert de passage trouvaient la pension excellente), cueillette des cerises jaunes, juteuses, et fouille des nombreuses armoires où s'amalgamait le bazar d’un bon siècle, la maison fut un lieu de vacances et d’apprentissages, un paradis de désordre et de découvertes ; les horloges y battaient un temps calme et doux, et le jus de pomme, le lait et la limonade y coulaient en ruisseaux. Quand on en repartait, c’était un peu comme dans les contes où trois ans n’avaient paru que trois jours.
Les enfants étaient trop petits pour mesurer ce que les murs et leur fraîcheur de calcaire avaient abrité de chagrins – Germaine et François avaient enterré un petit garçon, puis l’un des grands fils du premier mariage de François –, mais c’était aussi parce que leur grand-mère avait miraculeusement trouvé, avec le temps, comment changer ce plomb en or : de la plaie jamais refermée, elle avait tiré encore plus d’amour à distribuer à tout ce qui passait, sur deux pattes ou sur quatre. Eja mater, fons amoris, ô mère, fontaine d’amour… Ils virent seulement cette catholique, aussi profondément croyante que peu prosélyte (la religion était, pour elle comme pour lui, une aventure intime et personnelle), laisser une veilleuse allumée en permanence au-dessus d’un petit portrait de celle qui avait su, comme elle, ce que c’est que de pleurer un enfant.
François est mort en 1981. Germaine n’est partie qu’en 2018, à 99 ans. Elle avait vieilli sans lui mais dans ses traces et dans le souvenir de leur amour, et j’espère que, au fond du brouillard qui avait pris progressivement possession de sa tête, elle a gardé jusqu’au bout la joie, dont elle nous faisait part encore il n’y pas si longtemps, d’être en route pour le retrouver. Longtemps après que le déclin cérébral ait défiguré l’humour, la générosité, la capacité de tendresse, d’ironie et d’indulgence qui la caractérisaient, elle gardait comme un unique point fixe la présence invisible de celui qu’elle n’appelait plus que « François » ou « mon mari », comme si elle avait oublié que nous le connaissions – et ce détail, s’il pinçait le cœur, était aussi un rappel des plus justes : oui, avant d’être le père de ses enfants, a fortiori bien avant d’être mon grand-père, François était l’amour de sa vie.
Après avoir, l’année qui s'achève, fait nos adieux à Germaine, nous allons, en 2019, les faire à la maison. Cela nous fait mal au ventre – chacun à sa manière propre –, mais c’est ainsi. Il est temps qu’elle commence une nouvelle histoire, et nulle cote mal taillée immobilière ne nous rendra ce dont le deuil nous étreint si fort : ce n’est pas la perte des murs qui nous serre la gorge, c'est l’énormité intolérable du fait que les gens passent et leurs mondes avec eux. François et Germaine avaient bâti leur bulle (qui s’était encore étendue plus tard lorsque leur voisine et amie, âgée, sans enfants et désormais veuve, leur avait proposé l’achat de sa propre maison, avec ses pâtis et son vieux hangar de pierre haut comme une église), une bulle palpable de ciment, de dessins, d’arbres et de bambous, qui a longtemps coïncidé avec l’autre bulle de leur amour et de leur histoire. Mais la première ne peut longtemps survivre à la seconde, ou plutôt elle ne peut plus survivre qu’en acceptant l’effacement : s’évaporer à son tour plutôt que s’écrouler seule.
J’espère que le nouveau propriétaire respectera les oiseaux en bas-relief qui s’envolent dans l’entourage des fenêtres, et les carreaux de faïence peinte, souvenirs du jour où François mit ses filles à contribution pour leur propre version de la faïence de Quimper. Mais je sais que nous ne pouvons pas le lui demander. Je sais aussi que les points de couleur de la petite cuisine, eux, n’ont aucune chance de survie. Comme on dit si précisément, ils ont fait leur temps ; ils n’étaient qu’une irisation de la bulle. Il nous restera, à nous, de l’avoir connue : non – ou pas encore – l’hypothétique douceur du souvenir classé, mais la solidité douloureuse du savoir et de l’être. Nous en venons, de cette bulle ; nous en sommes faits. Et c’est un privilège que d’avoir baigné dans tant d’amour ; c’est une chance immense que d’avoir le cœur si gros, si tard, juste parce qu’est enfin venue l’heure banale et scandaleuse des adieux.